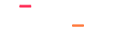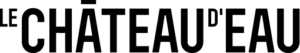Anaïs Tondeur « Ce que les yeux ne saisissent »
- Exposition
- Lieu Galerie le Château d'Eau
-
Public
- Tout Public
- À partir de 10 ans
- Tarif 3€ - 2€ - Gratuit - 6 ans
Cette exposition rassemble trois séries Fleurs de feux, Carbon Black and Chernobyl Herbanium.
VERNISSAGE le jeudi 5 juin à 18h
> VISITE de l'exposition avec l'artiste et la commissaire d'exposition Cristina Ferraiuolo : Samedi 7 juin à 14h
- Billet en ligne
Anaïs Tondeur, artiste engagée dans une nouvelle forme d’art politique associe des procédés analogiques du début de l’histoire de la photographie à des pratiques écologiques.
Dans cette démarche, elle explore de nouvelles façons de raconter le monde, porteuses de transformations de notre relation aux autres, au vivant et aux grands cycles de la terre.
Exposition présentée en collaboration avec Spot home Gallery de Naples - - Commissariat Cristina Ferraiuolo
Par des protocoles photographiques et sensibles, Anaïs Tondeur travaille à exposer l’intouchable dans des écosystèmes affectés par les activités anthropiques.
Elle interroge, à travers les mondes qui implosent, les interdépendances profondes qui relient nos existences humaines à la trame du vivant.
Toujours en quête de nouvelles alliances, elle développe une pratique en artiste de terrain, travaillant l’image comme une surface sensible par laquelle elle invite à rencontrer et penser êtres et éléments invisibilisés, leur donnant une agentivité, jusque dans la matérialité même du tirage.
« Dans la pratique d’Anaïs Tondeur, la photographie acquiert une signification à la fois matérielle et éthique. Plutôt que de représenter la pollution atmosphérique, la contamination nucléaire ou le stress induit par la toxicité des sols, elle laisse l’empreinte matérielle témoigner de la présence des substances létales dans l’air ou dans le corps des plantes. À mesure que la distance entre l’objet photographié et son support s’amenuise, l’engagement de l’artiste grandit : engagement à éviter toute idéalisation, à transformer ses œuvres en canaux d’expression du monde au bord du chaos. Le contact photographique se révèle alors à la fois tactile et empreint de tact.
Ses œuvres tracent un chemin vers d’autres formes de résistance: d’abord en enregistrant esthétiquement l’expérience indigeste – ou l’inexpérience – de la radioactivité, de la toxicité et des pollutions diverses, la transformant ainsi intérieurement pour la rendre assimilable ; ensuite, en rejoignant les plantes dans leurs propres efforts pour neutraliser les métaux lourds et les radionucléides, pour guérir la terre et soigner le monde.
Ni désespérées ni porteuses d’espoir, ses œuvres invitent à une autre approche de notre condition planétaire inéluctable, une approche à inventer et réinventer, par chaque spectateur touché par les traces du désastre, auxquels elles offrent un témoignage silencieux ».
Michael Marder
BIOGRAPHIE
Née en 1985. Travaille et vit à Paris.
Se penchant sur les matérialités invisibles de l’air et du climat, des plantes et des sols, Anaïs Tondeur développe des enquêtes par l’image comme outils anthropologiques. Elle saisit les images aux interstices des corps et des environnements, dans des sites marqués par l’activité humaine où elle cultive des engagements singuliers, pointant d’autres formes de relations et de matérialités photographiques.
Diplômée de la Central Saint Martin (2008) et du Royal College of Arts (2010) à Londres, nominée au Prix Pictet 2025, mention d’honneur des Amis du Jardin Albert Kahn (2024), lauréate du Grand Prix RPBB (2024), du Prix Photographie et Sciences, Résidence 1+2 (2023), du soutien à la mobilité artistique MIRA, Institut français (2023), du Prix Art of Change 21 et récipiendaire de la Mention d’honneur Cyber Arts, Ars Electronica (2019), elle a présenté et exposé son travail dans des institutions internationales telles que la Maison Européenne de la Photographie, Centre Pompidou (Paris), FR, MAMAC (Nice), Kröller-Müller Museum (Pays-Bas), Museum Ostwall, Dortmund U, Museum für Kunst und Gewerbe, (Allemagne), Kunst Haus Wien (Autriche), Chicago Art Center, Spencer Art Museum (USA), Choi Center (Beijing), Nam June Paik Art Center, Sungkok Art Museum (Corée du Sud).
“Anaïs Tondeur construit une nouvelle forme d'art engagé. Loin des utopies qui ont volé en éclat, il est un engagement dans le monde, d'autant plus politique que concret”…“Panser le monde pour mieux le re-penser et y ré-inclure l'humain, avec les autres —animaux, plantes, roches, eaux— est un des soubassements de la création de Tondeur.”
Annick Bureaud, ArtPress
Le lieu



RENCONTRE AVEC L’ARTISTE ET LA COMMISSAIRE D’EXPOSITION
Cristina Ferraiuolo :
« C’est la première fois, qu’est présentée une expo avec ces trois séries majeures. Noir de carbone, Tchernobyl herbarium et fleurs de feu. Jamais encore présentées ensemble.
L’idée, en fait, qu’on a imaginé avec Anaïs pour cette exposition, c’est des fils rouges qui lient les trois séries.
Et c’est en fait ce qui nous échappe à l’oeil, ce qui n’est pas visible. »
Anaïs Tondeur :
« Ma démarche, c’est une démarche qui se développe vraiment en réaction aux crises multiples auxquelles nous sommes en train de faire face, aussi bien au niveau sociétal, qu’écologique, aussi bien biodiversité que climatique. A chaque fois je vais travailler de manière située, vraiment, dans une immersion à l’intérieur d’un milieu qui est souvent marqué par l’activité anthropique. Et pour ça je vais suivre des éléments qui en effet nous échappent, des éléments qui sont négliger, invisibilisés, alors ça va être des particules de noirs de carbone, des métaux lourds, la radioactivité, mais aussi des éléments de nos propres corps, par exemple des larmes.
Ce qui m’intéresse en suivant ces éléments qui nous échappent, c’est à partir d’eux, de penser la façon dont nos vies sont totalement inter-reliées au milieu dans lequel nous vivons parmi les autres vivants, et non pas à l’extérieur de ces milieux de vie.
Chaque projet est pensé comme une sorte de protocole photographique qui nous ramène à une expérience sensible ancrée et qui est vraiment de nous réinsérer dans les grands cycles du vivant. La surface photographique devient une surface sensible pour donner une voix à ces entités invisibilisées, avec ce principe de donner une voix, c’est reconnaître aussi la gentilité de sujets, comme par exemple des plantes.
Par le procédé photographique, de trouver un moyen de leur laisser une forme possible d’expression.
Noir de carbone, c’est une série que j’ai développée il y a quelques temps avec des physiciens du centre de recherche de la Commission européenne à Ispra. Ces physiciens au moment où j’étais en résidence, tentaient de suivre les flux de particules fines. Donc là précisément, les particules de Noir de carbone, qui sont des particules, pas microscopiques, mais micronscoptiques, donc elles mesurent 2,5 microns. Ca veut dire qu’en fait elles ne connaissent aucune frontière géographique. On en trouve un grand nombre qui se déplacent en suivant les courants atmosphériques. Et donc elles vont par exemple se déposer à la surface de l’Artique, à la surface de la glace, créer un film fin noir. Ce film noir attire les rayons du soleil qui réchauffe la glace et indirectement participe à la hausse du niveau des mers. Ces particules étant tellement petites, elles ne connaissent aussi aucune frontière entre l’extérieur et l’intérieur de nos corps, et donc on en retrouve un grand nombre qui se sédimentent à l’intérieur de nos propres organes.
Je me suis rendue sur une des îles les plus sauvages de l’Europe. Cette île s’appelle l’île de fer, et elle se trouve au nord de l’Écosse. Arrivée sur cette île, j’ai envoyé mes coordonnées géographiques aux physiciens qui ont pu déterminer d’où promenaient les particules fines que l’on respirait ce jour de mai, et en fait les particules avaient été émises 1350 km dans le sud de l’Angleterre, dans le port de Folkestone. Donc ils m’ont envoyé la carte que vous voyez là-bas et le principe a été de retracer en sens inverse la trajectoire suivie par ces particules de noir de carbone chaque jour en réalisant un portrait du ciel.
Donc là vous pouvez voir sur la vidéo quelques vues du parcours et le masque que je portais pour filtrer les particules de noir de carbone.
Le noir de carbone est particulièrement intéressant parce qu’il fait partie de la même famille que la suie et la suie étaient utilisées depuis des siècles pour créer de l’encre de Chine. Donc ça nous a mis sur la piste de composer une encre à partir de ces particules de noir de carbone. Donc c’est ce que vous voyez à l’intérieur de chaque fiole. Ce sont des particules en suspension ici, des particules qui ont été extraites des fibres du masque. On a placé les masques dans un bain d’ions, et donc ça va permettre de faire vibrer la matière et des particules sont tombées et on a pu récupérer ces particules. Et ensuite j’ai collaboré avec un imprimeur pour composer une encre. Donc c’est une base d’encre pigmentaire à l’intérieur de laquelle se trouve ces particules de nord de carbone. Et donc il y a une cartouche par portrait de ciel et ça permet d’être dans une corrélation entre le niveau de noir de carbone, le jour où j’ai réalisé la photographie, et l’intensité des noirs à l’image. Donc si par exemple, on regarde le premier portrait de ciel qui est le phare de l’île de fer, là le niveau de noir de carbone est à 2,12 microgrammes par mètre cube d’air. Donc on voit finalement qu’il n’y a pas une grande intensité de noir à l’image. Alors quelques jours plus tard, dans la mer du Nord, là le niveau de noir de carbone a augmenté et on est à 13,86 microgrammes par mètre cube d’air.
C’est une façon de réfléchir à la façon dont nous sommes aussi exposés au milieu.
Tchernobl Herbarium, qui est composé par un mode d’exposition bien particulier, parce que là, c’est la radioactivité qui est contenue à l’intérieur des plantes qui participe à l’exposition de ces plantes sur la feuille photosensible.
Le point de départ est à nouveau une rencontre avec des chercheurs, cette fois-ci des biogénéticiens, qui depuis 2005, ont commencé à étudier l’impact de la radioactivité sur la flore à Tchernobyl dans la zone d’exclusion. J’ai proposé un déplacement, et justement, d’aller penser le trauma issu de l’explosion de Tchernobyl, mais par, et avec ces plantes qui poussent dans ces sols irradiés.
C’est un projet qui se développe et grandit d’un rayogramme par année passée depuis l’explosion. Chaque année, je vais retrouver les biogénéticiens qui vont partager une des plantes qu’ils ont étudiées et ensemble on va réaliser ce rayogramme.
Donc là ce qu’on fait, c’est qu’on place la plante sur la feuille photosensible et c’est la radioactivité qui est contenue à l’intérieur de la plante qui participe à l’exposition de la silhouette de la plante sur la plaque photosensible. Et donc là ce que vous voyez ce sont des tirages pigmentaires des originaux que je n’ai pas le droit de présenter en public parce qu’ils sont légèrement radioactifs.
Ce projet a rencontré la trajectoire de Michael Marder. C’est le philosophe de la pensée végétale qui lui a été directement exposé dans son propre corps à la catastrophe de Tchernobyl parce qu’en 1986 il vivait à Moscou. Il avait un fort problème d’asthme et ces médecins l’avaient envoyé dans un sanatorium à Anapa. Et précisément le 26 avril 1986 il traversait l’Ukraine pour, pendant trois semaines, tenter de réparer ses bronches.
Pour chaque rayogramme, Michael Marder va écrire un texte, un fragment textuel qui revient sur sa propre expérience intime dans son propre corps et qui ouvre à, finalement, ce que l’explosion de Tchernobyl a fait à notre société occidentale. Et malheureusement, finalement l’actualité fait qu’il y a énormément de sujets à repenser par rapport à ce contexte géographique, géopolitique et notre rapport au nucléaire.
Ce rayogramme a été réalisé en 2022, exactement au début de la guerre en Ukraine. Les biogénéticiens m’avaient, cette fois ci, non pas partagé une plante, mais du sol. Sol qui, au début de la guerre, a été particulièrement retourné. Les 25 26 février, plusieurs bombes sont tombées dans la zone d’exclusion. En 1986 le sol de surface était tellement radioactif qu’il a été enterré sur lui-même. Donc là, avec les bombardements, c’est tous ces radionucléides qui se retrouvent libérés dans l’atmosphère et les soldats russes ont creusé des tranchés. En fait, au bout de 3 semaines ils ont dû fuir la zone. Et finalement, pour une des premières fois dans l’histoire de la terre ce n’est pas l’ennemi qui repousse l’armée opposante mais la terre elle-même. Donc là, on entre dans une vraie forme de géopolitique.
Ce travail qui devient aussi un appui par l’image, par ce protocole photographique qui devient une façon de penser des questions extrêmement contemporaines auprès de ces plantes qui finalement continue de se développer et résistent relativement bien à ce contexte extrême. Parce que les biogénéticiens ont pu observer qu’au bout de 5 générations seulement, les plantes avaient muté. Là, c’est une mutation qu’on ne peut pas voir à l’œil nu. C’est une mutation qui a lieu au niveau des cellules mères et cette mutation leur permet de continuer de vivre dans ce contexte extrêmement perturbé.
C’est un projet qui me porte particulièrement parce que j’ai l’impression aussi d’apprendre de ces plantes. D’apprendre de la façon dont elles continuent de faire monde malgré la dévastation de la zone d’exclusion.
La troisième série, qui est présentée ici, s’appelle Fleur de Feu.
Ce projet poursuit un compagnonnage avec des plantes qui poussent dans des sols extrêmes. C’est vraiment une zone qui se trouve autour du Vésuve, et qui, depuis les années 60, a été marquée par un écoside, généré par l’éco-mafia, qui a fait disparaître un grand nombre de déchets toxiques, et pas toujours toxiques. Des déchets qui viennent de Naples, du nord de l’Italie, même du nord de l’Europe, tous ces déchets que l’on a l’impression de recycler, et qui, pour certains, suivent une autre trajectoire.
Ces déchets ont été ou enfouis, donc dans certaines zones, comme par exemple, à Terre Digno ou à Ercolano. Les déchets sont enfouis dans d’anciennes carrières creusées directement dans les flancs du Vésuve. Donc à Terre Digno, c’est 300 mètres de profondeur de déchets qui remplissent un de ces cratères. Et dans d’autres endroits, les déchets ont été incinérés, d’où le nom Terre des feux.
L’idée était de travailler à partir de ce milieu particulièrement marqué, ces sols, chargés en métaux lourd, et de travailler auprès des plantes qui poussent dans ces sols. Alors, on n’a pas travaillé avec n’importe quelles plantes, mais avec des plantes rudérales. L’éthymologie du terme rudéral vient de rudéris, la ruine. En fait, Carl von Linné, ce grand botaniste, a nommé ces plantes parce qu’il les observait principalement dans des ruines archéologiques. Il ne pouvait pas imaginer que quelques siècles plus tard, ces plantes pousseraient dans d’autres types de ruines, les ruines du capitalisme, les ruines de la société.
Ces plantes, en fait, poussent dans ces sols chargés en métaux lourds et en réaction à la présence de ces métaux lourds, elles vont surproduire une certaine molécule qui s’appelle le phénol. Je suis particulièrement intéressée par le phénol parce qu’en photographie argentique, le phénol peut remplacer le bain de révélateur. Donc, c’est une possibilité de développer des procédés photographiques moins toxiques pour les milieux. Là, c’est vraiment la photographie qui est développée à partir de cette décoction de plantes. Je vais ajouter un peu de vitamines C et de la cendre collectée directement sur la terre des feux. Donc, ça me permet d’activer le phénol présent dans la plante. Pour d’autres projets, je vais développer mes photographies avec ces décoctions de phénol, mais là, c’est un procédé différent. C’est à nouveau comme pour Tchernobyl herbarium de la photographie de contact. Donc, je vais activer le phénol présent dans la plante et ensuite, placer une feuille photosensible sous la plante. C’est la plante qui vient, non pas exposer, mais révéler son empreinte. Donc, c’est vraiment ce que vous voyez, le résultat entre le contact, la rencontre entre la feuille photosensible, les allogénures d’argent et le phénol de la plante. Et finalement, c’est un procédé qui donne une forme d’agentivité à ces plantes en collectant ce que j’ai appelé une phytographie, donc une écriture végétale. Ecriture végétale que j’ai envoyé au philosophe Michael Marder, qui a adressé une réponse à ces plantes. Il a écrit une lettre à ces plantes. Avec Cristina, nous sommes retournés auprès de la plante pour lui lire le texte du philosophe. Pendant le temps de la lecture, je réalisais une nouvelle empreinte photographique, et comme ça, pendant un an, nous sommes entrés dans une forme de correspondance interespèces. Vous pouvez voir l’ombre de dégradement de ces lettres. Ici l’ensemble des lettres ont été adressés à la plante.
Donc, en tout, on a travaillé avec 9 communautés de plantes, qui poussent sur 9 sites emblématiques de la Terre des Feux, où autour du Vésuve, où le long d’un axe, qu’on a suivi, qui s’appelle aço médiano, qui est vraiment un axe qui sépare l’urbain du rural. Ou en fait, un des agronomes qu’on avait rencontrés, décrit ce lieu comme une sorte de barrière de l’horreur.
Sur un autre support, donc là, en fait, ce sont des textiles que j’ai collectés sur la Terre des Feux, donc où il y a des réseaux de tri des déchets, ou directement à la décharge. Et après, ces tissus, je vais les sensibiliser pour pouvoir reprendre le même principe de photographie de contact et révéler l’empreinte de ces plantes sur les tissus qui venaient directement du site lui-même.
De manière globale, ce que j’essaie de mettre en mouvement, c’est un travail du regard. Mais là, cette idée de penser le regard comme un égard, cette idée de développer des protocoles, des expériences qui, par le biais de l’image, vont nous amener à développer une forme d’attention, de présence autre, à ces êtres qui vivent dans ces lieux particulièrement perturbés. Et comment, en retour, cette expérience nous apprend aussi, d’autres façons d’évoluer, potentiellement d’autres façons de cohabiter dans cette fine couche de peau terrestre que certains ont appelé la zone critique. Donc, dans ce mouvement, de donner attention, visibilité à ces êtres négligés et en même temps d’apprendre de leur façon différemment de l’habiter après la dévastation.
Et donc c’est finalement assez emblématique de ce que j’essaie de mettre en mouvement dans ma pratique, finalement des gestes politiques, mais qui ne sont pas dans un rapport frontal, mais d’essayer aussi, par les processus eux-mêmes, d’incarner une autre façon d’interagir, d’être au milieu et que ce soit pas juste à un niveau conceptuel et philosophique, mais de l’incarner aussi par la pratique même, soit dans l’attention au sujet que je vais rencontrer et dans la façon de leur donner une voix.